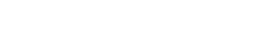[Grospierres]
Aux abords du dolmen, Aude fouille le sol à l'aide d'un pinceau. Elle essaie de comprendre la position de certaines pierres, tentant d'identifier quelque agencement d'origine humaine.
Son équipe a déjà retrouvé quelques pierres plates qui, verticalement, constituaient un couloir menant à l'édifice :
« Le problème c'est que le calcaire est de très mauvaise qualité, donc il s'effrite à l'air libre, » explique l'archéologue un peu déçue.
|
|

[Grospierres]
Après avoir exploré la chambre du dolmen, les 9 archéologues fouillent les alentours et le tumulus proprement dit.
Pendant un mois, ils déblayent le cailloutis sans déranger la disposition des rochers originels. En creusant, ils exhument le sol préhistorique qui est plus noir et plus compact :
« Pour le moment, c'est extrêmement chaotique… je ne comprends pas ce qui se passe, » indique modestement Sonia, spécialiste des dolmens en Ardèche.
|

[Grospierres]
Dès que les archéologues trouvent un élément intéressant sur le tumulus, ils tamisent le cailloutis et la terre :
« Quand on a un doute, on pose l'objet sur la langue, et si ça colle, c'est un os ! » confie Joséphine (au premier plan), étudiante en master d'archéologie à Paris I.
|
|

[Grospierres]
Sonia et son équipe découvrent quelques dents, des petits ossements, de la céramique… D'autres archéologues sont déjà passés par là dans les années 1950, mais leur fouille a été négligente :
on retrouve notamment des os dispersés en nuage, à cause de seaux de tamisage vidés ça et là, sans précaution.
|